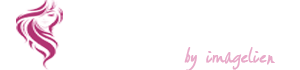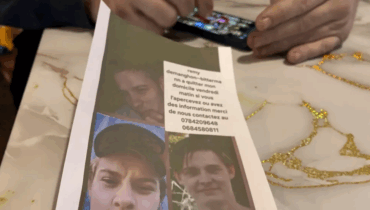Et si les juges étaient élus plutôt que nommés ? « Une fausse bonne idée », dénoncent les magistrats

Publié le 1 juillet 2025 par: Être Heureux
La proposition de Vincent Jeanbrun, visant à élire les juges au suffrage universel pour restaurer la confiance entre citoyens et justice, a provoqué un tollé dans les milieux judiciaires. Magistrats et syndicats dénoncent une initiative populiste, dangereuse pour l’indépendance de la justice et déconnectée des réalités du terrain.

Dans un document de 36 pages intitulé « Réparer les quartiers, rétablir la République », le député LR Vincent Jeanbrun défend l’idée d’un changement radical : élire les juges du siège. Inspirée, selon lui, de modèles existant dans « d’autres démocraties » comme les États-Unis, la Suisse ou le Japon, cette mesure serait un moyen, affirme-t-il, de rétablir la confiance des Français dans leur système judiciaire. Il précise que ces élections ne porteraient pas sur des opinions politiques, mais sur la capacité des juges à rendre une justice « juste, rapide, humaine ».
Mais pour la majorité des professionnels du droit, cette mesure sonne comme un retour en arrière périlleux.
Une mesure ancienne… et abandonnée
Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats (USM), rappelle que l’élection des juges a déjà été testée en France, à l’époque de la Révolution. En 1790, les juges étaient élus au suffrage populaire, mais cette mesure a été abandonnée en 1802 par Napoléon, en raison de son inefficacité. Plus tard, les « juges de paix », magistrats non professionnels désignés pour trancher les petits litiges, ont également été supprimés pour leur manque de compétence et leur image de notables locaux partiaux.
Selon Ludovic Friat, la justice est un domaine technique, exigeant un haut niveau de formation, une rigueur déontologique et une indépendance totale vis-à-vis des pressions extérieures.
Le spectre de la corruption et des pressions locales

Au cœur de la critique, un risque central : la perte d’indépendance des juges, noyés dans les enjeux électoraux. Friat s’inquiète : « Comment un juge pourrait-il statuer en toute impartialité dans une affaire sensible s’il est redevable aux électeurs de son quartier, ou s’il a été soutenu par un parti politique ? » Pire, il redoute l’intérêt que pourraient y trouver les réseaux criminels, notamment les narcotrafiquants, qui disposeraient de moyens considérables pour influencer des campagnes locales.
L’exemple mexicain est cité en contrepoint : Silvia Delgado, avocate liée au cartel de Joaquín « El Chapo » Guzmán, a récemment été élue juge. Une dérive jugée inquiétante.
Un manque de moyens plutôt qu’un manque de légitimité
Face à ces critiques, les syndicats de magistrats s’accordent sur un constat commun : le problème de la justice française n’est pas sa légitimité, mais le manque criant de moyens. Ludovic Friat dénonce une justice « au bord de l’effondrement », qui ne tient que par le surinvestissement de ses agents : greffiers, magistrats, avocats, tous épuisés par des charges excessives et des infrastructures vétustes.
« Donnez-nous les moyens pérennes de fonctionner, plutôt que d’inventer des réformes dignes du concours Lépine », ironise-t-il.
Une autre vision de la responsabilité judiciaire

Judith Allenbach, présidente du Syndicat de la magistrature, rejoint l’opposition à cette mesure, mais propose d’autres pistes pour renforcer la confiance des citoyens. Selon elle, la responsabilité des magistrats peut être accrue sans passer par leur élection. Elle alerte elle aussi sur les dangers d’une justice politisée, mais estime que si le lien entre justice et population est distendu, c’est avant tout à cause des politiques qui affaiblissent la structure judiciaire au fil des années.
Parmi ses propositions :
-
Doubler le nombre de magistrats formés, pour permettre des décisions plus collégiales et des délais raisonnables ;
-
Moderniser les tribunaux, pour un meilleur accès du public à ses juges ;
-
Rétablir la participation citoyenne dans les procès criminels, aujourd’hui réduite à une portion congrue.
Publicité: